Du jour au lendemain, votre beau-père s’est mis à tenir des propos incohérents. Il avait déjà des pertes de mémoire qui devenaient de plus en plus fréquentes. Ce nouveau signal vous inquiète : s’agit-il d’un épisode passager ou faut-il envisager une démence sénile sans perspective de traitement ?
Cet article fait le point sur ce qu’on appelle la démence sénile : à quelles maladies renvoie ce terme, quels sont ses symptômes et les perspectives en termes de prise en charge et d’espérance de vie pour les personnes âgées qui en sont atteintes ?
Qu’est-ce que la démence sénile ?
Si le terme de « démence sénile » est toujours utilisé dans le langage courant, ce n’est pas une définition médicale. Il peut en effet recouvrir de nombreuses pathologies.
Pourquoi le terme « démence sénile » n’est plus utilisé en médecine ?
La notion de démence sénile désignait autrefois une personne âgée présentant des symptômes très hétérogènes liés au seul poids de l’âge comme à une maladie liée à une dégénérescence cognitive.
Cette confusion retarde souvent l’appel au médecin, et la mise en œuvre de traitements : le milieu médical n’utilise plus cette terminologie obsolète et éloignée de la réalité biologique.

Existe-t-il une définition médicale de la démence sénile ?
Il n’existe pas de définition clinique de la démence sénile. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recourt au terme de « démence » qui définit des symptômes pathologiques pouvant renvoyer au diagnostic de nombreuses maladies : altération de la mémoire, difficultés de langage, de raisonnement, d’apprentissage, désorientation…
Les médecins préfèrent identifier des symptômes et suivre l’évolution de la démence sénile pour poser un diagnostic précis : maladie d’Alzheimer, démence à corps de Lewy, maladie de Parkinson, mais aussi conséquences d’AVC ou dégénérescence lobaire frontotemporale.
Les symptômes initiaux renvoyant à la notion de démence sénile
Les premiers signes d’une possible démence sont de plusieurs ordres :
- Un début de perte de mémoire touchant les événements les plus récents ;
- Des difficultés à se repérer dans le temps et/ou dans l’espace ;
- L’apparition de comportements anormaux : décisions irrationnelles, changements de caractère ou d’humeur.
Souvent légers, diffus et occasionnels, ils sont souvent difficiles à relier à l’entrée en maladie.
Démence sénile : combien de temps peut-on vivre après le diagnostic ?
L’espérance de vie des seniors varie considérablement selon la maladie que recouvre le diagnostic et le stade auquel celle-ci a été découverte.
Quelle espérance de vie moyenne pour une maladie neurodégénérative ?
La question de l’espérance de vie, ou plus précisément de la durée de vie après un diagnostic de démence sénile chez une personne âgée de 65 ans ou plus tient d’abord à la nature de la pathologie. Des études menées sur des cohortes de patients âgés parviennent aux moyennes suivantes.
| MALADIE | ESPÉRANCE DE VIE APRÈS DIAGNOSTIC |
| Maladie d’Alzheimer | 8-10 ans |
| Démence vasculaire | 5 ans |
| Démence à corps de Lewy | 6 ans |
| Démence frontotemporale | 6-8 ans |
| Maladie de Parkinson (après 65 ans) | 13-14 ans |
Source : British Alzheimer’s Society
Il s’agit de moyennes, qui peuvent être positivement ou négativement affectées par de nombreux autres facteurs.
Quels facteurs influent sur l’espérance de vie dans la démence sénile ?
L’espérance de vie d’une personne âgée atteinte d’une maladie neurodégénérative dépend aussi d’autres facteurs :
- L’âge au moment du diagnostic : plus l’on est âgé, plus la durée de vie est courte ;
- Les comorbidités ou maladies dont souffre déjà le senior : des pathologies lourdes peuvent affecter sensiblement l’espérance de vie moyenne ;
- La qualité des traitements et de la prise en charge ;
- Maintien à domicile ou orientation vers une unité Alzheimer : un bon accompagnement, une prise en charge précoce et des soins adaptés peuvent prolonger la durée de vie ;
- L’engagement de l’aidant familial dans l’accompagnement de son proche joue également un rôle important.
Pourquoi chaque cas est-il unique ?
Une moyenne n’est qu’un calcul sur la base de statistiques. La durée de vie après un diagnostic de démence sénile peut être très éloignée des chiffres annoncés. Elle est très liée :
- Au mode et à l’hygiène de vie de la personne âgée : activité physique, alimentation, addictions…
- À son suivi médical : est-il bien suivi, est-il observant dans ses traitements ?
- À son environnement : pollution, vie sociale, proximité familiale…
À retenir : les 3 signes d’aggravation qui annoncent une perte d’autonomie rapide
1. Difficulté à accomplir les tâches quotidiennes (se lever, se déplacer, s’habiller…)
2. Troubles de la mémoire : oublis de plus en plus fréquents (rendez-vous manqués, perte d’objets…)
3. Changements d’humeur : repli sur soi, agressivité…
Les stades de l’évolution de la démence sénile
Les principales maladies neuro-dégénératives connaissent des évolutions comparables, selon trois étapes.
Stade léger : désorientation et troubles de mémoire
La personne conserve son autonomie, mais commence à présenter les premiers troubles : oublis répétitifs, difficultés à organiser son quotidien, légère désorientation temporaire.
Stade modéré : le besoin d’une assistance quotidienne
Les troubles cognitifs s’aggravent. Les oublis deviennent récurrents et peuvent mettre la personne âgée en danger, le senior a du mal à communiquer, peut être fortement désorienté, ne plus pouvoir accomplir certains gestes du quotidien. C’est le moment où la dépendance s’installe réellement.
Stade sévère : dépendance profonde et complications physiques
La personne présente une dépendance totale dans les actes de la vie quotidienne. Elle ne reconnaît plus ses proches, peut être alitée ou en fauteuil toute la journée, et peut commencer à présenter des complications physiques. Son état général se détériore, annonçant la fin de vie.
Accompagner une personne atteinte de démence sénile jusqu’à sa fin de vie
Face à une démence sénile, les proches de la personne âgée peuvent l’accompagner pour lui assurer un bien-être durable.
Le rôle majeur des aidants et de la famille
Les proches du senior jouent un rôle central dans la prise en charge de sa maladie. Ils vont ainsi permettre son maintien à domicile, entretenir des liens sociaux avec lui, participer à la mise en place d’un plan d’aide pour son maintien à domicile ou l’aider à trouver un EHPAD.
Les soins en EHPAD et en unité Alzheimer
Lorsque l’évolution de la démence sénile ne permet plus un maintien à domicile, l’entrée en unité Alzheimer est la meilleure option. Elle dispose d’équipes formées et propose, dans un environnement sécurisé, des soins et activités thérapeutiques stimulant les fonctions cognitives et une vie sociale.
LIRE AUSSI : Quels soins et quels accompagnements pour une personne de 90 ans atteinte de démence ?

Préserver le bien-être de la personne âgée en perte d’autonomie
Les seniors âgés en phase de dépendance profonde ont besoin d’un accompagnement adapté et permanent pour traverser la maladie.
La douleur peut être physique, liée à une pathologie ou à la dégradation des fonctions biologiques, mais également psychiques, les crises d’angoisse étant fréquentes et violentes. Des traitements adaptés, des activités spécifiques (kinésithérapie, massages, ambiances relaxantes…) peuvent ainsi fortement la soulager.
Lorsque la dépendance est importante se pose la question de la dignité de la personne. Les équipes des EHPAD sont formées pour s’occuper de leurs résidents avec des gestes professionnels et des paroles apaisantes, éloignant tout sentiment d’humiliation.
En phase terminale de démence, les établissements mettent en place des soins palliatifs avec un accompagnement psychologique et spirituel et un soutien pour les proches.
Quelle prise en charge publique de la démence sénile ?
Entrée en établissement, aménagement du domicile, soutien des aidants : il existe des aides pour accompagner la personne âgée malade et ses proches.
Des aides pour financer le coût de la dépendance
Pour les personnes âgées en perte d’autonomie, en particulier celles atteintes de démence, plusieurs dispositifs aident à financer la dépendance :
- L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : ouverte à toute personne de 60 ans et plus évaluée GIR 1 à GIR 4 sur l’échelle de la dépendance, elle permet de financer des aides à domicile ou une partie du coûte de la dépendance en établissement ;
- L’Aide sociale à l’hébergement (ASH) est dédiée aux personnes résidant dans un EHPAD habilité à l’aide sociale, et disposant de ressources modestes. Elle prend en charge partiellement l’hébergement en EHPAD ;
- La réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD tributaires de l’impôt sur le revenu. Elle permet de déduire 25 % des frais d’hébergement en EHPAD dans la limite de 10 000 € de frais.
Quand envisager l’entrée en EHPAD ou en unité Alzheimer ?
L’entrée en EHPAD ou en unité Alzheimer doit être envisagée dès que la dépendance s’installe et que les proches et aidants familiaux ne peuvent plus y faire face.
Un soutien psychologique pour les familles
S’occuper d’une personne Alzheimer est difficile physiquement, et psychologiquement. Voir son proche décliner et adopter des comportements incohérents peut être terrible. Les associations de familles de patients comme France Alzheimer organisent des groupes de parole et des rencontres entre familles.
FAQ pratique
Quelle est la différence entre démence sénile et Alzheimer ?
La démence sénile est un terme ancien et trop général désignant un déclin intellectuel lié à l’âge ou à une maladie. La maladie d’Alzheimer, elle, est une cause précise de démence, caractérisée par une atteinte des neurones.
Peut-on ralentir la progression de la démence ?
Oui, dans certains cas. Une prise en charge précoce, un suivi médical régulier, une stimulation cognitive et sociale, une activité physique adaptée et un environnement sécurisé peuvent ralentir l’évolution de la démence.
Quand faut-il envisager un placement ?
Il devient nécessaire d’envisager un placement en EHPAD ou en unité Alzheimer lorsque la personne ne peut plus vivre seule en sécurité : désorientation, chutes, fuites, agitation nocturne ou perte de repères.
La démence est-elle mortelle ?
Indirectement, oui. Les différentes formes de démence provoquent une dégradation progressive du cerveau et des fonctions vitales. En phase terminale, les complications entraînent souvent le décès.
Comment se passe la fin de vie en EHPAD ?
En EHPAD, la fin de vie est accompagnée par une équipe formée : soulagement de la douleur, attention au confort, accompagnement psychologique des proches. Les soins palliatifs visent à maintenir la dignité et à éviter toute souffrance inutile.


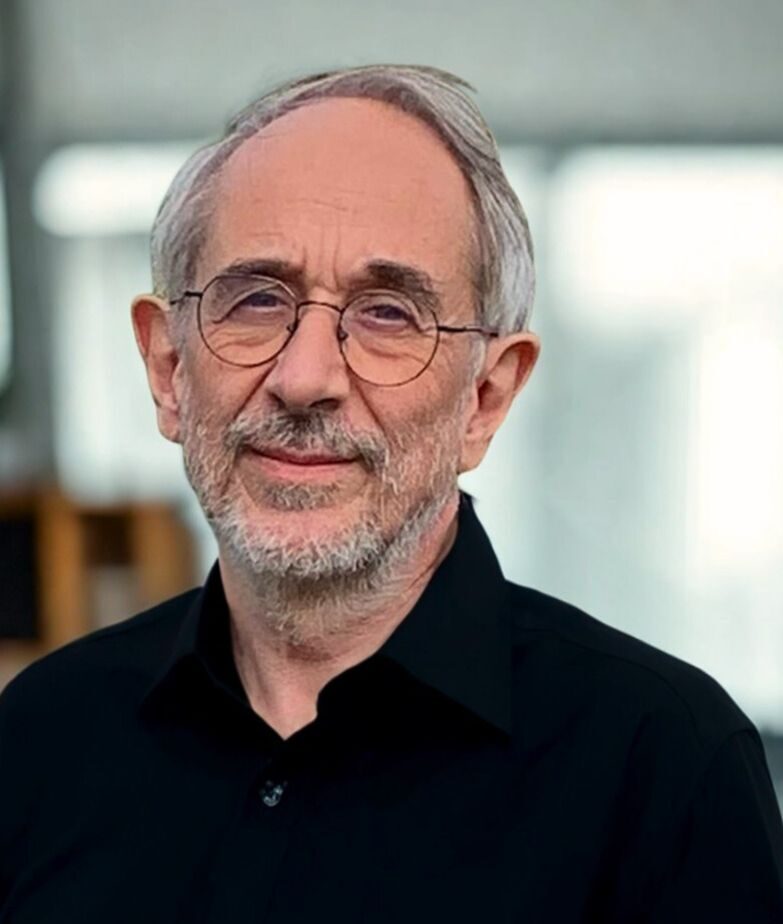



Laissez un commentaire