Votre mère vient d’être diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer. Pour l’instant ses symptômes sont légers, quelques oublis, une certaine désorientation à certains moments, parfois des propos incohérents. Mais vous savez qu’à son âge, la dégradation de son état de santé peut être rapide. Vous vous trouvez confronté à un dilemme : pouvez-vous lui permettre de rester chez elle, ce qu’elle souhaite ardemment malgré sa solitude ? Ne vaut-il pas mieux chercher dès à présent une place dans une unité protégée d’un EHPAD ? Pour vous aider dans votre choix, cet article vous présente les cinq différences essentielles dans la prise en charge entre ces deux solutions.
1. Surveillance et sécurité à domicile ou en EHPAD pour les malades d’Alzheimer
L’un des risques de la maladie d’Alzheimer comme des autres démences séniles est la mise en danger de la personne âgée qui en est atteinte. De l’oubli de fermer un robinet de gaz à l’errance extérieure, les menaces sont innombrables.
Protéger la personne âgée à son domicile
Au domicile, l’environnement est familier et rassurant. Votre proche conserve ses repères, ce qui peut atténuer l’intensité des symptômes de la maladie. Mais lui assurer une vie « sûre » requiert la mise en place de nombreuses mesures.
- Une adaptation de son environnement à sa condition de santé : des chemins lumineux, des systèmes associant détecteurs de mouvement et éclairage, de gestion automatique des plaques de cuisson, etc., sont très utiles pour sécuriser les gestes du quotidien.
- La mise à disposition d’un dispositif GPS porté par votre parent (collier, bracelet…) afin de vous prévenir d’une chute ou d’une sortie extérieure non prévue, hors d’une zone de proximité de son domicile.
- La venue régulière d’auxiliaires de vie et de personnels de services : assurant une présence auprès de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, ils sont un maillon indispensable dans le dispositif de sécurité.

L’unité de vie protégée en EHPAD, conçue pour garantir la sécurité des résidents
Les unités de vie protégées Alzheimer des EHPAD sont conçues spécifiquement pour accueillir les personnes âgées souffrant de maladies neurodégénératives. Leur architecture prend ainsi en compte les risques liés aux troubles cognitifs et à des comportements erratiques. Tout l’environnement des bâtiments est pensé pour prévenir les fugues et sécuriser les déplacements. Parcours guidés au sein des établissements, systèmes de sécurité aux portes, personnel important et toujours présent…, les résidents sont sous surveillance 24 h/24.
2. Encadrement médical et soins pour Alzheimer : à domicile ou en établissement ?
S’il n’existe pas encore de traitement pour guérir de la maladie d’Alzheimer, des soins spécifiques permettent d’en ralentir l’avancée et participent au bien-être des patients qui en sont atteints.
À domicile, une prise en charge sur mesure
La prise en charge à domicile d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée nécessite la collaboration coordonnée de plusieurs professionnels de santé :
- Des infirmiers assurant des soins médicaux, susceptibles de surveiller l’état de santé du patient ;
- Un kinésithérapeute qui doit permettre au malade de conserver sa motricité ;
- Un orthophoniste qui peut prendre en charge les troubles du langage ;
- Un neurologue qui peut aider la personne âgée à gérer ses troubles cognitifs et émotionnels ;
- Éventuellement un garde de nuit…
- S’ajoutent les prestations d’auxiliaires de vie : préparation des repas, présence affective, ménage, etc.
Ce sont les proches aidants qui doivent organiser et coordonner toutes ces interventions, et réagir en urgence lorsqu’un intervenant fait défaut.
Des soins intégrés dans l’organisation de l’unité protégée en EHPAD
Dans une unité protégée Alzheimer, les soins de gérontologie sont assurés sur place. Les personnels de santé interviennent quotidiennement pour gérer les atteintes de démence, les risques de dénutrition, l’agitation ou les troubles de comportement. L’équipe médicale sous la responsabilité du médecin coordonnateur assure une prise en charge globale.
3. Le maintien d’une vie sociale
Les troubles du comportement et les maladies neurodégénératives ont pour effet d’isoler les malades : le malade a tendance à fuir les situations d’interaction. Lutter contre cette tentation d’isolement est essentiel pour que les seniors poursuivent une existence dans un certain bien-être.
Lorsque le patient réside à son domicile, c’est avec les proches aidants et certains amis qu’il peut continuer à poursuivre une vie sociale par des visites plus ou moins régulières. La venue de soignants et d’auxiliaires de vie renforce le lien social.
En EHPAD, le malade d’Alzheimer vit en collectivité. Il est en contact de façon permanente non seulement avec le personnel soignant mais aussi avec les autres pensionnaires. Il bénéficie ainsi d’interactions plus fréquentes et variées qu’à domicile. La visite régulière des proches reste un élément essentiel pour préserver le lien affectif.
4. La stimulation cognitive pour limiter l’effet de la maladie d’Alzheimer
Au-delà des traitements et soins thérapeutiques, la pratique régulière de certaines activités permet de ralentir les symptômes de la maladie, en particulier sur la mémoire.

Quelles activités pour un malade d’Alzheimer à domicile ?
De nombreuses activités peuvent être proposées à la personne âgée demeurant chez elle comme par exemple :
- Des jeux de société aux règles simples : Monopoly, dominos, jeux de cartes, etc. Cela fait travailler la concentration et la mémoire ;
- Des conversations autour de photos : faire s’exprimer la personne âgée, raconter des moments de son existence sur la base de photographies, l’exerce à mieux maîtriser le langage et à se concentrer ;
- De même, le jardinage, la couture, le tricot, le dessin, les mots croisés, etc., ont un rôle positif sur le cerveau et le corps.
Des activités collectives en EHPAD
Les résidents des unités de vie protégées peuvent participer à de nombreux ateliers adaptés : atelier mémoire, musicothérapie, Snoezelen, jardin thérapeutique, art-thérapie, zoothérapie en particulier sont conçus pour maintenir les capacités cognitives et ralentir l’évolution de la maladie. Les interactions quotidiennes avec les autres résidents et les professionnels renforcent la qualité de vie et l’attachement à celle-ci.
5. Évolution de la maladie, une prise en charge différentielle
Le maintien à domicile est souvent choisi lorsque les symptômes d’Alzheimer restent gérables, soit au début de la maladie. La personne âgée reste valide et capable, moyennant certains aménagements, de vivre décemment chez elle. Lorsque la situation s’aggrave et que les troubles deviennent de plus en plus importants, la prise en charge devient plus lourde, exigeant une présence quasi permanente et pesant sur les aidants.
L’hébergement en unité protégée Alzheimer permet de suivre l’évolution de la pathologie dans un cadre stable et médicalement sécurisé. Le personnel s’adapte aux conditions de chaque résident, les soins évoluant avec le patient, sans changement de lieu ni de repères.
EHPAD versus maintien à domicile : un tableau comparatif
| Critère | Aide à domicile | Unité protégée Alzheimer |
| Sécurité | Adaptations domestiques, surveillance limitée | Encadrement 24h/24, espace sécurisé |
| Soins médicaux | Intervenants externes coordonnés par la famille | Prise en charge pluridisciplinaire intégrée |
| Vie sociale | Risque d’isolement, activités irrégulières | Activités quotidiennes et encadrement professionnel |
| Charge familiale | Forte implication, fatigue possible | Délégation des soins, accompagnement des proches |
| Évolution maladie | Évolutif selon les besoins et les stades. Peut atteindre des limites. | Cadre stable, sécurisant et adapté aux évolutions d’Alzheimer |


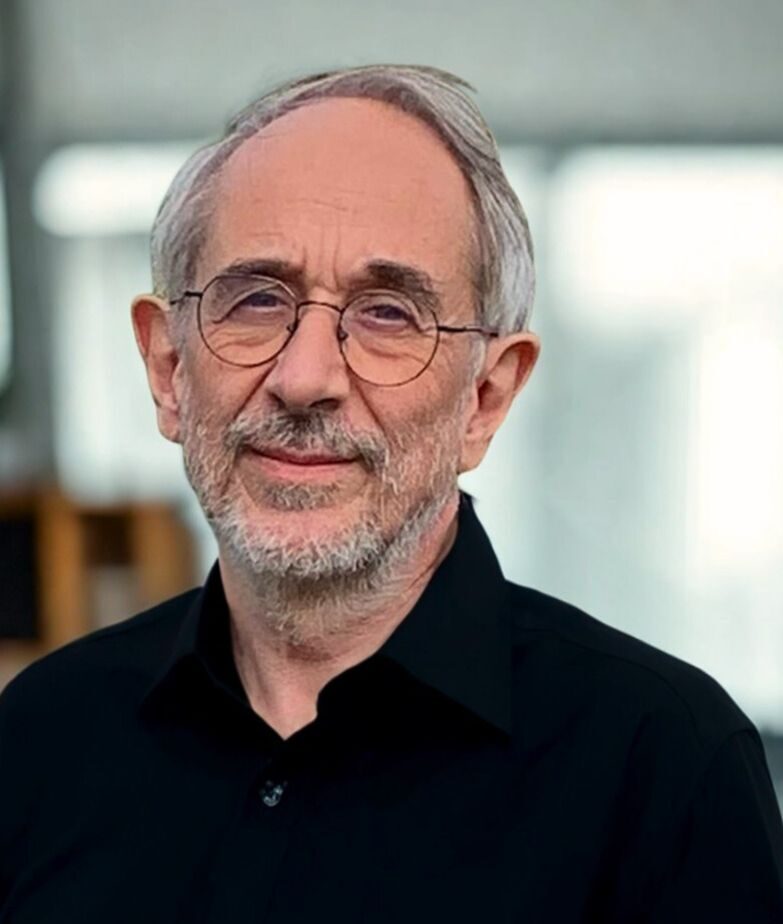



1 Commentaire
Ayme Joëlle
16 Juil 2025Mon mari est en ephad. Nous en sommes très content. Personnel super. Dommage que ça soit se cher , proprietaire pas aides. Obligée de penser à vendre la maison, c’est injuste sacrifice de toute une vie. La vieillesse se finit mal